Apprendre que la propriété convoitée est grevée d’une servitude peut susciter bien des interrogations, voire un certain stress. De prime abord, cette notion juridique peut sembler complexe et dissuasive, surtout lorsqu’elle vient limiter certains droits du futur propriétaire. Pourtant, dans bien des cas, la servitude s’avère essentielle au bon fonctionnement de la cohabitation entre voisins et loin d’être un obstacle, elle peut même prévenir des conflits.
Avant d’aller de l’avant avec l’achat d’un immeuble, il est fortement recommandé de consulter un notaire. Ce professionnel pourra non seulement expliquer en détail les obligations juridiques liées à une servitude, mais aussi vérifier, en amont de la transaction, si la propriété est effectivement concernée. Le notaire demeure aussi la personne à consulter si une servitude doit être créée à la suite d’une entente entre voisins.
Dans cet article, découvrez ce qu’est une servitude, les différents types existants, leurs effets sur votre droit de propriété et les façons de mettre fin à ce genre d’engagement.
Qu’est-ce qu’une servitude immobilière ? Définition
Une servitude est une restriction légale imposée à un immeuble (le fonds servant) au profit d’un autre immeuble, d’un propriétaire ou d’un service public (le fonds dominant ). Elle limite certains droits d’usage du propriétaire, comme l’interdiction de construire dans une zone précise ou l’obligation de laisser un droit de passage.
Contrairement à un droit de propriété, une servitude n’apparaît pas sur le plan cadastral. Elle est plutôt décrite en détail dans une description technique d’arpentage, préparée par un arpenteur-géomètre. Une fois créée, elle est généralement publiée au Registre foncier du Québec, ce qui la rend opposable à tous les futurs propriétaires.

Comment une servitude peut-elle être créée ?
Au Québec, une servitude ne peut pas découler d’un simple usage prolongé, même si celui-ci est toléré depuis des années. Sa création doit respecter l’une des formes reconnues par la loi, afin d’être valide et opposable aux tiers. Trois situations principales permettent de créer une servitude en toute légalité.
Par contrat
Il s’agit de la méthode la plus courante. Deux propriétaires, souvent voisins, concluent une entente écrite précisant les droits accordés et les obligations de chacun. Par exemple, un propriétaire peut autoriser son voisin à traverser son terrain pour accéder à la voie publique. Une fois signée, la servitude est publiée au Registre foncier du Québec, ce qui garantit sa reconnaissance par tous les futurs propriétaires.
Par testament
Un propriétaire peut aussi léguer une servitude par voie testamentaire, en faveur d’un individu ou d’un immeuble. Cette disposition devient exécutoire au moment du décès, pourvu qu’elle soit également inscrite au Registre foncier. Elle s’applique alors aux nouveaux propriétaires, comme toute servitude enregistrée.
Par la loi
Certaines servitudes naissent automatiquement en vertu de la loi. C’est notamment le cas lorsqu’un terrain est enclavé, c’est-à-dire qu’il ne dispose d’aucun accès à la voie publique. Le propriétaire a alors droit à une servitude légale de passage sur le terrain voisin le plus approprié. Cette servitude peut être reconnue par le tribunal même en l’absence d’un contrat formel.
Quels sont les différents types de servitude ?
Il existe deux grandes catégories de servitude au Québec : la servitude réelle et la servitude personnelle. Chacune comporte des particularités juridiques qui influencent directement l’usage d’un immeuble.
1. La servitude réelle
La servitude réelle est la plus fréquemment rencontrée. Elle établit un lien juridique entre deux immeubles distincts :
- Le fonds servant qui supporte la servitude ;
- Le fonds dominant qui en bénéficie.
De nature permanente, la servitude réelle peut toutefois prendre fin si le contrat le prévoit expressément ou si elle devient inapplicable avec le temps. Elle est opposable aux propriétaires futurs dès sa publication au Registre foncier du Québec. Parmi les formes courantes de servitudes réelles, on trouve :
La servitude de passage
C’est la plus répandue. Elle permet au propriétaire d’un terrain enclavé d’accéder à la voie publique en passant par le terrain voisin. Ce droit de passage est essentiel lorsqu’aucun autre accès n’est possible.
La servitude de vue
Au Québec, la loi interdit l’installation de fenêtres à moins de 1,5 m de la limite d’une propriété voisine. Une servitude de vue peut toutefois être accordée pour autoriser une ouverture dans ce rayon, à condition que les deux parties en conviennent par contrat.
La servitude de drainage
Fréquemment utilisée en milieu agricole, elle permet à un propriétaire de faire l’écoulement des eaux de surface de son terrain vers un terrain adjacent. Cette servitude vise à prévenir les accumulations d’eau nuisibles à l’exploitation ou à l’usage du sol.

La servitude d’empiètement
Lorsqu’une construction dépasse légèrement sur un terrain voisin, une servitude d’empiètement peut être conclue pour régulariser la situation. Elle évite d’avoir à démolir ou à modifier l’aménagement existant.
La servitude d’utilité publique (municipale, Hydro-Québec, etc.)
Créée au bénéfice d’une entité publique (une municipalité, Hydro-Québec, Vidéotron, etc.), cette servitude vise à permettre l’entretien ou l’accès à des infrastructures techniques comme de poteaux, câbles ou canalisations. Le propriétaire du terrain doit en permettre l’accès en tout temps, sans pour autant céder la propriété de la parcelle concernée.
2. La servitude personnelle
La servitude personnelle diffère de la servitude réelle en ce qu’elle est accordée non pas à un immeuble, mais directement à une personne physique. Elle constitue donc un avantage individuel, non transférable, qui cesse automatiquement au décès de son bénéficiaire.
Même si elle n’est pas liée à une propriété, la servitude personnelle doit, pour être opposable aux futurs propriétaires du fonds servant, être publiée au Registre foncier du Québec. Par exemple, si un propriétaire (Marie) accorde à une personne spécifique (Philippe) le droit de passer sur son terrain, cette autorisation demeure valide même si Marie vend sa maison, tant que la servitude est inscrite au registre.
Il peut toutefois être difficile de distinguer clairement une servitude personnelle d’une servitude réelle, surtout lorsque les termes du contrat manquent de précision. Dans ce cas, l’intention des parties et l’interprétation du document contractuel peuvent faire l’objet d’un litige. C’est pourquoi les tribunaux peuvent être appelés à trancher lorsque la nature exacte de la servitude est contestée.
Comment peut-on mettre fin ou annuler une servitude ?
Une servitude peut prendre fin de plusieurs façons, selon les circonstances prévues par le Code civil du Québec. Outre le décès du bénéficiaire, dans le cas d’une servitude personnelle, les situations suivantes permettent elles aussi de mettre fin aux obligations légales :
- Réunion des propriétés : si une même personne devient propriétaire des deux immeubles concernés, le fonds servant et le fonds dominant, la servitude cesse automatiquement, puisqu’elle devient sans objet.
- Renonciation officielle : les parties concernées peuvent convenir de mettre fin à la servitude. Pour qu’elle soit opposable à tous, un acte de renonciation ou de résiliation doit être publié au Registre foncier du Québec.
- Arrivée de l’échéance prévue : certaines servitudes sont créées pour une durée déterminée ou jusqu’à la réalisation d’une condition. Lorsque la servitude arrive à terme ou que la condition est atteinte, la servitude prend fin d’elle-même.
- Rachat de la servitude : l’une des parties peut décider de racheter la servitude en versant un montant convenu à l’autre. Ce montant peut être établi par entente mutuelle ou fixé par un tribunal.
- Non-usage pendant 10 ans : si une servitude n’est pas exercée durant une période ininterrompue de 10 ans, elle peut être considérée comme éteinte, sauf exception reconnue par la loi.
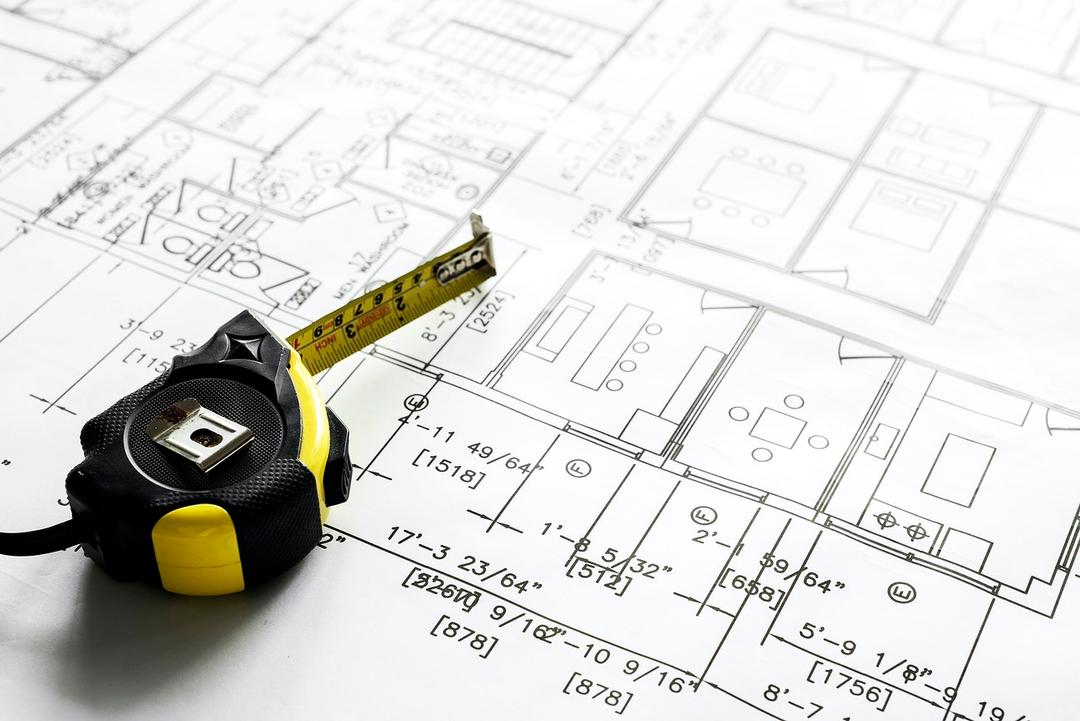
La description technique : un acte essentiel pour créer une servitude
La description technique est un document légal produit par un arpenteur-géomètre dans le but de délimiter précisément une portion d’un terrain. Contrairement au certificat de localisation, qui est principalement informatif et utilisé lors d’une vente, la description technique a une valeur juridique contraignante et sert à établir des droits réels, notamment lors de l’établissement d’une servitude. Ce document comprend :
- Un plan détaillé du terrain concerné, indiquant les limites précises et l’emplacement de la servitude.
- Un rapport explicatif décrivant les dimensions, la position et la vocation du terrain visé, en lien avec les terrains voisins
La description technique est nécessaire pour officialiser une servitude dans les cas suivants :
- Elle accompagne l’acte notarié lors de la création de la servitude.
- Elle est publiée au Registre foncier du Québec, ce qui la rend opposable à tout futur propriétaire.
- Elle peut être utilisée pour repérer une servitude existante dans le cadre d’une transaction immobilière.
À ne pas confondre avec le certificat de localisation : Le certificat de localisation sert à représenter l’état actuel d’une propriété, incluant les bâtiments, les servitudes visibles et les empiètements. Il ne permet pas de créer une servitude et n’a pas pour fonction de délimiter précisément une portion de terrain dédiée à un droit réel.
FAQ — Servitude immobilière
Comment trouver une servitude dans le registre foncier ?
Une servitude publiée est inscrite au Registre foncier du Québec, accessible en ligne. Vous pouvez effectuer une recherche par adresse ou numéro de lot pour consulter les actes notariés et descriptions techniques qui confirment l’existence d’une servitude.
Quelle est la différence entre une servitude et un droit de passage ?
Le droit de passage est un type de servitude qui permet à un propriétaire d’accéder à sa propriété en traversant un terrain voisin. La servitude est un terme plus large, qui inclut d’autres droits comme la vue, le drainage ou l’accès aux équipements publics.
Combien coûte une servitude de passage ?
Le coût varie selon la complexité du terrain et les frais professionnels impliqués. Il faut prévoir :
- Les honoraires du notaire pour la rédaction et la publication (souvent entre 700 $ et 1 500 $).
- Les frais d’arpentage pour la description technique (environ 1 000 $ à 2 000 $).
- Parfois, une compensation financière est aussi versée au propriétaire du fonds servant.
Vous cherchez un arpenteur-géomètre de votre région?
XpertSource.com peut vous aider dans vos démarches pour trouver un arpenteur-géomètre. En nous parlant de votre projet, nous vous mettrons gratuitement en relation avec les personnes-ressources adéquates. Vous n’avez qu’à remplir notre formulaire (en quelques minutes seulement) et vous pourrez être mis en contact avec des experts.

